Voici quelques années à peine, l’Europe était très largement gouvernée par les socialistes et les sociaux-démocrates. Or, durant cet intermède inédit, la gauche n’a pas fondamentalement détourné l’Europe de la route vers une société de marché libérale. Désormais, le monde est à nouveau gouverné à droite, et la gauche se trouve doublement défaite : battue dans les urnes, mais aussi sans doctrine claire, assumée et crédible. Après avoir abandonné sa visée révolutionnaire pour se transformer en gestionnaire de la démocratie de marché, la gauche européenne a certes démontré sa capacité à alterner avec la droite, mais elle semble impuissante à incarner une alternative durable au néolibéralisme. Pour tous ceux qui, à droite, estiment qu’une telle alternative est impensable, le socialisme n’est pas en crise, il est tout naturellement agonisant. C’est l’état d’esprit que M. Raffarin a exprimé en déclarant que, dans sa marche vers le paradis, la France était encore au "purgatoire, puisqu’il reste des socialistes". L’avenir ne serait donc pas à la refondation idéologique d’un socialisme moderne, mais à l’alternance d’un club de centre droit et d’un club de centre gauche partageant un même modèle de société, plus ou moins amendé selon les préoccupations prioritaires de leurs clientèles électorales respectives.
La tentation de la "troisième voie"
Cet état d’esprit n’est pas très éloigné de celui de quelques rares hommes de gauche qui, à l’instar de Michel Rocard, constatent que "le capitalisme a gagné" et qu’en conséquence nous, les socialistes, "ne construisons pas la société de nos rêves", "nous nous défendons", c’est tout. Nous devrions alors avoir l’honnêteté de reconnaître que nous n’avons pas la capacité de proposer des réformes sensiblement différentes de celles de la droite. Dans cette optique, l’avenir du socialisme n’est pas la rénovation, c’est la mort. En France, la modernisation du PS consisterait dès lors à le convertir en parti de centre gauche — éventuellement allié à l’UDF — abandonnant à un "pôle de radicalité " les utopiques incantations gauchistes. Ce n’est heureusement pas là le point de vue dominant à gauche. Mais néanmoins, la façon dominante de poser la question d’un renouveau du projet socialiste n’évite pas sa dilution dans le centrisme. En effet, chez la plupart des "modernisateurs" déclarés en Europe, il est habituellement convenu que les mutations économiques et sociales des trente dernières années ont rendu obsolète un logiciel idéologique faisant la part belle à la régulation politique de l’économie, à la protection sociale, aux services publics, à la redistribution, à la mobilisation collective, bref à l’État et à la solidarité collective. Le socialisme moderne devrait donc renoncer à l’étatisme, s’adapter à la métamorphose du monde, sans pour autant adopter l’idéologie du tout marché qui gagne la droite. Il s’agit, comme l’a théorisé le sociologue anglais Anthony Giddens au milieu des années 1990, de trouver une "troisième voie" entre le socialisme ancien et le néolibéralisme.
Un diagnostic néolibéral qui ne dit pas son nom
Ce programme de recherche, popularisé par les discours et la politique de Tony Blair, s’appuie sur trois prétendus "constats", trois diagnostics sur l’état des sociétés capitalistes contemporaines. Je montrerai plus loin que ces prétendus constats sont une reconstruction idéologique et erronée de la réalité.
1er prétendu constat
La supériorité économique avérée de l’économie de marché sur la planification centralisée et l’effondrement consécutif des régimes communistes entraînent la généralisation du principe de libre concurrence et donc une intensification inédite de la compétition mondiale. L’impératif de compétitivité qui en résulte interdit l’usage des méthodes anciennes de régulation qui alourdissent les charges fiscales et sociales et entravent la flexibilité et la mobilité du travail et du capital. Un pays seul n’a pas les marges de manœuvre nécessaires pour imposer un modèle social original rejeté par ses concurrents.
2e prétendu constat
La tertiarisation, le déclin de la classe ouvrière, le progrès du niveau de vie et les mutations des modèles productifs engendrent une hétérogénéité sociale croissante. Le combat politique ne peut plus se poser en termes de lutte des classes ou d’affrontement travail-capital, car les lignes de partage de la société passent aujourd’hui à l’intérieur d’un salariat éclaté en multiples catégories, dont certaines ont des intérêts communs à ceux du capital, tandis que d’autres, exclues des fruits de la croissance et du marché du travail, ont des intérêts contradictoires avec ceux des travailleurs les mieux intégrés. Cela contraint les socialistes à rechercher une base électorale plus large et plus diversifiée.
3e prétendu constat
Les sociétés de marché avancées sont le lieu d’une mutation culturelle qui se traduit par une montée de l’individualisme et du consumérisme. Il s’ensuit une résistance aux règles universelles imposées par l’autorité, un appétit de consommation personnelle diversifiée limitant la propension à financer des biens collectifs, bref une certaine dilution du sens de l’intérêt général et de la solidarité collective.
L’ambition essentielle de la troisième voie est de démontrer que, face à ces mutations, la gauche peut rester fidèle à ses valeurs tout en bouleversant ses instruments d’action pour y intégrer de façon pragmatique certaines des prescriptions libérales. Ainsi, puisqu’on ne peut échapper à ce fait incontournable qu’est la compétition mondiale exacerbée, le nouvel enjeu des politiques sociales est "l’égalité des chances" : il faut armer chacun pour le combat, en recentrant l’action publique sur la création d’un environnement familial et éducatif favorable et sur la formation-reconversion permanente. L’État n’a pas à défendre les salariés et les chômeurs contre les inéluctables effets de la compétition, mais doit mieux les préparer et les inciter à s’y engager pour devenir les acteurs de leur réussite. Il s’agit de remplacer une logique d’assistance par une philosophie de la responsabilité individuelle. D’où le slogan premier de la troisième voie : "pas de droits sans responsabilités". Et côté stratégie, la troisième voie s’inspire de la tactique de "triangulation" testée par Bill Clinton : couper l’herbe sous le pied de la droite conservatrice, en reprenant certains de ses thèmes porteurs (sécurité, baisses d’impôts, responsabilité, etc.), et s’attacher l’électorat de gauche par quelques actions en faveur des classes défavorisées.
L'ennui majeur de ce diagnostic est qu'il est, en bien des points, semblable à celui des néolibéraux ; il a donc logiquement conduit des gouvernements sociaux-démocrates à recourir à des politiques habituellement recommandées par la droite libérale… au nom de la fidélité "modernisée" aux valeurs de la gauche !
Une stratégie vouée à l’échec
Les positions officielles des partis socialistes ou sociaux-démocrates sur cette "troisième voie" sont variées ; elles vont de l’adhésion du SPD allemand — qui en a proposé une variante plus libérale, le "nouveau centre" théorisé par Bodo Hombach — à la franche résistance du PS français. Mais dans la pratique, la gauche européenne a de fait souvent suivi les prescriptions libérales du blairisme. Elle a accepté ou contribué à la déréglementation des marchés, à la privatisation progressive des services publics, à la flexibilisation du marché du travail, à la baisse des impôts sur le revenu et des cotisations sociales patronales. Elle nous a "vendu" l’euro, le marché unique et l’élargissement européens comme les meilleurs remparts contre la généralisation du modèle néolibéral. Mais, à l’arrivée, l’immense majorité des salariés — qui est encore composée d’ouvriers et d’employés aux salaires modestes — n’a vu que l’intensification du travail, la modération salariale et la multiplication des plans sociaux, concomitantes de l’amélioration des marges financières ; et elle n’a pas compris l’impôt rendu aux classes supérieures alors que, partout, se font sentir les besoins publics insatisfaits dans l’école, la justice, le logement social, l’hôpital public, etc.
Cette politique a conduit la gauche européenne au fiasco électoral. Son bilan économique et social plutôt favorable n’a pu compenser le brouillage de son identité. Une politique patchwork qui a été perçue comme un clientélisme centriste n’a pas fait gagner de voix sur l’électorat de droite. Elle a seulement découragé une part croissante de l’électorat de gauche qui ne faisait plus la différence entre gouvernements libéraux et socialistes.
Presque partout en Europe, l’indifférenciation des politiques, le centrisme, le discours du juste milieu, de l’adaptation aux contraintes, ont entraîné le recul des socialistes, la montée de l’abstention et l’essor du vote extrême.
Fausse exception à cette règle, le SPD allemand a perdu toutes les élections depuis la première victoire de Schröder : la reconduction de ce dernier tient uniquement au progrès des écologistes qui ont seuls profité de l’engagement contre la guerre en Irak.
Seules vraies exceptions, les sociaux-démocrates suédois et les travaillistes anglais doivent cependant leur salut à un programme recentré sur la promotion du service public.
La stratégie de la troisième voie est donc une impasse politique. Elle écartèle la gauche entre la "trahison moderne" de son idéal et la "fidélité archaïque" d’une extrême gauche protestataire. Pour sortir de cette funeste alternative, il faut dessiner la voie d’une "fidélité moderne" au projet socialiste et démontrer que la question de son renouveau peut se poser autrement qu’en termes de troisième voie entre socialisme et néolibéralisme.
Renoncer au postulat de l'impuissance
La rhétorique de la troisième voie n’échappe pas à cette règle : la réponse à un problème est presque entièrement contenue dans la façon de le poser. Ainsi, l’impasse où conduit cette rhétorique est déjà inscrite dans la posture initiale d’impuissance qui consiste à prendre les trois prétendus constats que nous avons présentés comme des invariants du monde bornant le champ des possibles. Cela revient à énoncer d’emblée trois postulats d’impuissance politique déniant toute faisabilité à un quelconque projet de gauche.
1er postulat d'impuissance
Poser comme cadre impératif de toute politique l’exigence de compétitivité marchande dans une guerre économique mondiale toujours plus dure, c’est renoncer a priori à tout projet de transformation sociale. En effet, prendre la nature contemporaine de la concurrence comme une donnée incontournable force tout esprit cohérent à considérer ses effets constatés comme également incontournables : précarité et intensification du travail, recul des impôts et des biens publics, privatisation des assurances sociales et des services publics, montée des inégalités et de la violence, recentrage sur un État gendarme purement répressif puisque dépourvu des moyens de s’attaquer aux causes sociales de la violence.
Croire que l’on peut préserver un modèle social européen différent du néolibéralisme en faisant quelques concessions opportunes à cette logique de compétitivité est une douce illusion. Car la compétition ira croissante et, avec elle, le chantage à l’emploi et aux investissements qui justifie le dumping fiscal et social. Accepter aujourd’hui de céder au chantage et de se défendre à reculons face à une logique de guerre opposée à celle de la coopération solidaire, c’est accepter, dès le départ, de reculer jusqu’au bout.
Si le premier postulat est juste, il est parfaitement vain de chercher une autre voie que celle du néolibéralisme. Il n’y en a aucune. Et tous les chercheurs de énième voie ne feront que se ridiculiser dans de rocambolesques contorsions idéologiques qui les conduiront à prôner des politiques quasi semblables à celles de néolibéraux, mais au nom de valeurs radicalement opposées !
Il faudrait d’ailleurs être singulièrement inculte pour ne pas savoir que les valeurs de la troisième voie (l’égalité des chances et le culte de la responsabilité individuelle, entre autres) sont celles du néolibéralisme. L’affirmation "il n’y a pas de droits sans responsabilités", que Giddens présente comme le slogan résumant le mieux la " troisième voie " est en fait, mot pour mot, une citation de Margaret Thatcher !
2e postulat d'impuissance
Prendre acte du déclin d’une base électorale populaire pour en déduire la nécessité de programmes séduisant l’électorat traditionnel du centre et de la droite, c’est renoncer a priori à convaincre les classes aisées de soutenir des politiques plus favorables aux classes populaires, c’est se prédisposer à l’équilibrisme entre réformes de gauche et de droite, tactique qui a mené la gauche européenne au fiasco.
Tactique autoréalisatrice s’il en fut : se faire une raison de la désaffection des ouvriers et employés conduit à ne plus faire grand-chose pour la contrarier et donc à l’accentuer... et ainsi de suite.
3e postulat d'impuissance
Prendre la montée de l’individualisme et du consumérisme comme des données irréversibles, c’est postuler que l’égoïsme et l’intoxication marchande ont déjà largement installé la culture d’une démocratie sans citoyens, c’est-à-dire d’une communauté de clients — de ce que j’ai appelé une "dissociété" —, c’est-à-dire encore le modèle de société dérégulée, "marchéisée" et dépolitisée du néolibéralisme.
Évitons à ce stade tout malentendu. Quoique, bien entendu, je les rejette, je ne soutiens pas que les hypothèses présentées ci-dessus et le modèle néolibéral sont impensables. Je dis seulement que ces hypothèses et ce modèle sont indissociables. Le programme de recherche de la troisième voie est en conséquence mort-né, parce qu’il reconnaît comme des lois irréversibles de la nature des mutations économiques, sociales et culturelles qui sont incompatibles avec un quelconque projet de gauche, aussi modéré soit-il. Ce programme part du constat d’une impuissance irréductible du politique face à certaines lois du marché pour s’interroger ensuite sur les moyens de restaurer le pouvoir du politique. C’est aussi absurde que de chercher à développer la puissance d’une voiture tout en admettant qu’il est impossible de lui installer un moteur !
Les prémisses d’un renouveau socialiste
Un quelconque renouveau du socialisme commence donc par une autre lecture de la métamorphose du monde, lecture alternative qui seule autorise une réponse alternative. Cela commence par l’adoption d’une culture vraiment "moderne", c’est-à-dire volontariste, émancipatrice et non adaptationniste. Cela continue concrètement par la construction d’une alternative économique au capitalisme patrimonial, et par une révision radicale de la stratégie électorale de la social-démocratie.
1°) Évitons le contresens sur la modernité
Pour commencer, d’un point de vue méthodologique, être socialiste, c’est croire que le monde n’est pas ce qu’il est mais ce que l’on en fait, que les lois de l’économie restent les lois des hommes — façonnées par des institutions, des conventions sociales et des choix politiques —, c'est croire, enfin, que les croyances et les comportements sont influencés par l’environnement social dans lequel grandissent et vivent les individus. Les trois soi-disant "constats" qui induisent chez certains une logique d’adaptation du socialisme, ne sont donc pas des données exogènes, mais les résultats datés et mouvants d’une interaction sociale complexe dans laquelle l’action humaine délibérée joue un rôle essentiel.
Puisqu’elle le peut donc, la politique doit adapter le monde à son projet et non l’inverse, façonner patiemment ses contraintes et des marges de manœuvre et non les subir. Cette attitude est la seule qui soit "moderne" au sens que la philosophie politique donne à ce terme, à savoir : l’esprit de liberté initié par les "Lumières", mouvement d’émancipation de l’humanité à l’égard de toutes les lois qu’elle ne se donne pas elle-même.
À l’opposé de cette démarche, bien des "modernisateurs" du socialisme ont pris le terme au sens trivial et assez creux du dictionnaire : "être de son temps". Alors, puisque notre temps est celui du renoncement politique, de la toute-puissance des marchés, de la guerre économique et de la dépolitisation, leur socialisme moderne consiste à adapter la politique à l’impuissance du politique !
2°) Une économie alternative est possible
Au terme de vingt ans de libéralisation croissante de l’économie mondiale, on observe encore une grande diversité, de la protection sociale, du droit du travail ou de la dispersion des salaires. C’est bien le signe que le modèle de société reste largement déterminé par des rapports de force et des choix politiques localisés et qu’il est encore temps de choisir la suite de l’histoire. Par ailleurs, des pays comme la France ou des pays scandinaves restent en réalité parmi les plus attractifs pour les investisseurs étrangers, en dépit de leurs coûts salariaux, de leurs impôts, de leurs charges sociales tant décriés par les tenants de l’attractivité fiscale du territoire.
C’est que l’attractivité d’un pays tient aussi à la qualité de l’éducation, de la formation, de la recherche, des infrastructures, du cadre de vie, des synergies industrielles, de l’environnement, etc. Une politique sociale et industrielle active permet donc à une nation de choisir comment elle veut être compétitive et quel type d’activité elle veut attirer.
Le socialisme moderne ne refuse pas la compétition, mais il la conçoit comme un outil et non comme une contrainte imposée par les lois de la nature. C’est pourquoi, notamment, il exclut les biens publics de la libre compétition marchande parce que l’intérêt général exige qu’ils soient également accessibles à tous et non pas seulement en fonction des moyens et arbitrages financiers des individus.
Dans la sphère marchande, le socialisme moderne croit aux vertus de la concurrence régulée ; mais il refuse la guerre économique sans frein qui s’étend au détriment de l’égalité, de la dignité des salariés, de la cohésion sociale et de l’environnement. Il use donc pleinement des normes sociales et environnementales, de la fiscalité et des investissements publics pour changer l’enjeu du concours entre les nations et les individus : faire en sorte que le but du jeu soit la qualité de vie pour tous, la satisfaction de bien vivre ensemble, plutôt que l’accumulation réservée aux gagnants d’une lutte sans fin.
Cette alternative au capitalisme patrimonial au service exclusif des actionnaires est tellement possible... qu’elle existe déjà ! Le dynamisme des entreprises coopératives, des mutuelles, des associations constituant un vaste secteur d’économie sociale et solidaire, démontre la compatibilité d’une économie efficace, et même compétitive, en l’absence de toute recherche d’un profit privé. Aux États-Unis, temple du capitalisme patrimonial, les entreprises familiales non cotées en bourse affichent en moyenne des résultats supérieurs aux entreprises tenues d’optimiser la "création de valeur" pour l’actionnaire !
Nous évoluons donc dans des "économies plurielles" (plus diversifiées que ce que l’on entendait par "économie mixte") où la preuve est faite que l’incitation à maximiser le profit n’est en rien indispensable à la performance économique. Il suffit d’un peu de volonté politique et d’imagination pour éviter que cette "économie plurielle" ne se délite en économie unidimensionnelle commandée par l’obsession de la rentabilité marchande. Le politique peut systématiquement favoriser le développement des services publics, des coopératives, des mutuelles, de l’économie solidaire, au lieu de les condamner, par le jeu de la libre concurrence, à se comporter peu à peu comme des entreprises capitalistes.
Il faut bien entendu s’efforcer de faire avancer cette vision au sein de l’Union européenne, qui offrirait le cadre optimal pour imposer un modèle social progressiste. Mais certains instrumentalisent cette évidente nécessité pour étouffer tout volontarisme au plan national : au prétexte que l’on ne pourrait "faire le socialisme dans un seul pays", ils ne nous proposent guère mieux que de nous résigner à ne le faire dans aucun. L'Union européenne dominée par la vision adaptationniste devient toujours davantage l'outil qui renforce l'impuissance nationale sans la compenser par un renforcement du politique au niveau européen. Si l'on se contente d'attendre que tous les autres veuillent instaurer le socialisme moderne, on ne récoltera que la généralisation de la société de marché. La vision progressiste n’avancera réellement que si quelques pays sont déterminés à ne pas attendre que les autres commencent et à considérer cette finalité sociale comme une condition sine qua non d’un approfondissement de l’Union. La France doit être l'un de ces pays-là, et les socialistes doivent être de ceux qui conduisent la France à en être.
3°) Une stratégie électorale moderne
La logique adaptationniste a conduit les socialistes et sociaux-démocrates européens (comme la plupart des mouvements politiques) à suivre le penchant naturel de la démocratie d’opinion : l’enlisement dans un marketing politique médiocre et à courte vue qui additionne les soutiens achetés par une collection de mesures disparates.
La logique authentiquement "moderne" implique de rassembler sur une volonté de maîtriser collectivement notre histoire et de construire une société plus juste. La seule réponse socialiste envisageable à l’hétérogénéité sociale et à la conflictualité des intérêts, c’est la promotion de la République laïque et sociale qui garantit l’épanouissement de toutes les identités personnelles, en les unissant dans une communauté solidaire offrant à tous une égale capacité d’épanouissement. La mutation stratégique que doivent opérer les socialistes consiste donc à renoncer définitivement au marketing frileux qui évite les marqueurs idéologiques trop nets pour ne pas effrayer les électeurs supposés indécis. L’indécision naît justement de la confusion des marques. La seule stratégie moralement digne — et à terme politiquement efficace — consistera au contraire à opposer le projet socialiste d’une société pacifiée par l’égalité et la solidarité à celui d’une société de marché fondée sur la libre compétition généralisée. Pas plus que par le passé, les cadres supérieurs ne voteront à gauche parce qu’ils espèrent en retirer des avantages fiscaux supérieurs aux promesses des libéraux, mais parce qu’ils préféreront payer l’éducation, la santé et la retraite de leurs concitoyens pour progresser vers une société plus juste, plus solidaire, plus vivable, qu’ils seront fiers de léguer à leurs enfants. Parce qu’ils mourront la conscience plus tranquille d’avoir voulu une société sans perdants que d’avoir été dans le camp des gagnants. Alors tant qu’à faire du marketing, que les socialistes fassent du bon marketing ! Faire le pari que la clientèle potentielle d’un projet socialiste, c’est tout le monde : voilà leur seule chance de revenir au pouvoir avec les moyens de mettre en œuvre leur projet.

 a Roumanie va adhérer à l'Union. Pour fêter ça, le site des ambassades de Roumanie nous apprend que "le gouvernement vient de prendre des mesures d'allégement fiscal à effet immédiat. L'ordonnance d'urgence prévoit la baisse de l'impôt sur les sociétés de 25 % à 16 %". Comme les voisins baissent leur impôt sur les bénéfices, l'Allemagne fait pareil : l'impôt va passer de 38,3 % à 32 %. En quinze ans, le taux moyen d'impôt sur les bénéfices a déjà baissé d'un tiers en Europe. Pour la France, en 2005, c'est un manque à gagner de 17 milliards (l'équivalent du déficit de la Sécurité sociale plus deux fois le budget du CNRS...). Et le mouvement va s'accélérant.
a Roumanie va adhérer à l'Union. Pour fêter ça, le site des ambassades de Roumanie nous apprend que "le gouvernement vient de prendre des mesures d'allégement fiscal à effet immédiat. L'ordonnance d'urgence prévoit la baisse de l'impôt sur les sociétés de 25 % à 16 %". Comme les voisins baissent leur impôt sur les bénéfices, l'Allemagne fait pareil : l'impôt va passer de 38,3 % à 32 %. En quinze ans, le taux moyen d'impôt sur les bénéfices a déjà baissé d'un tiers en Europe. Pour la France, en 2005, c'est un manque à gagner de 17 milliards (l'équivalent du déficit de la Sécurité sociale plus deux fois le budget du CNRS...). Et le mouvement va s'accélérant. 


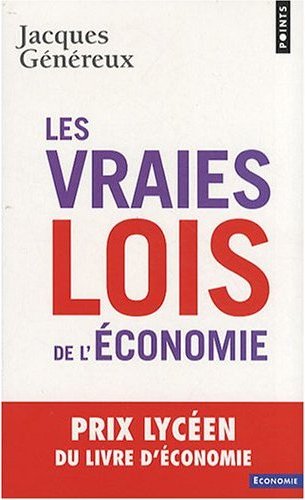
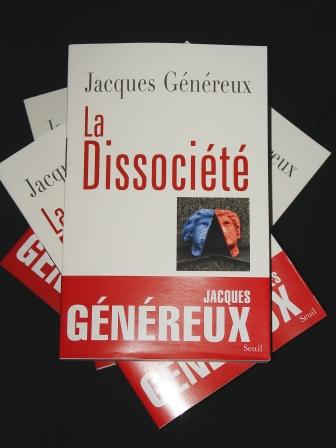
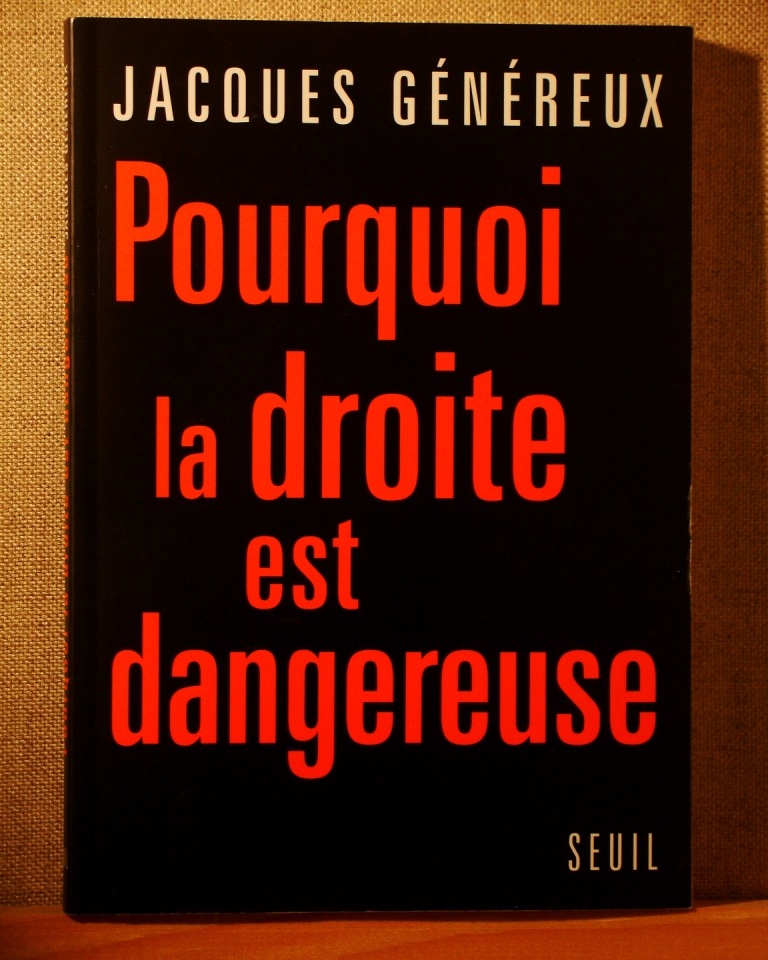
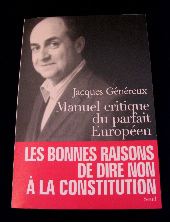
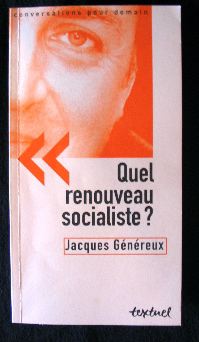
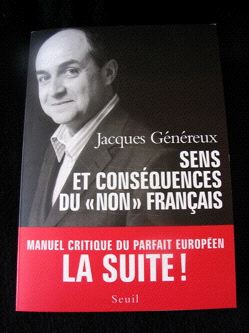
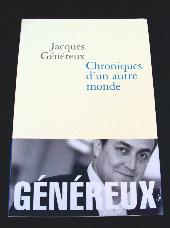
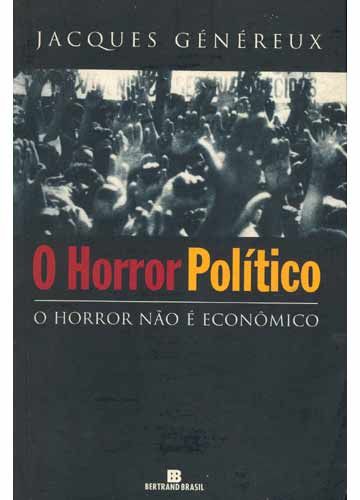
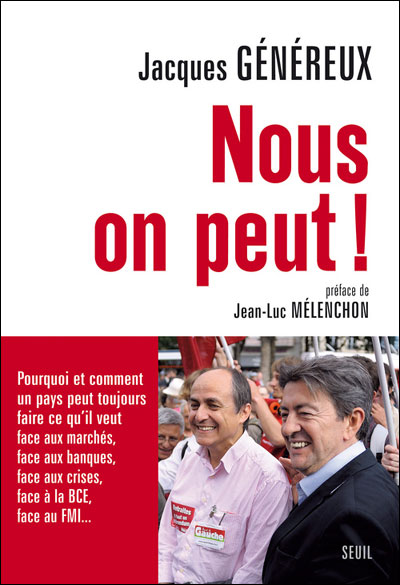
j'ai lu ton texte avec interet et je partage ton avis.Neanmoins ton dernier paragraphe implique une rupture avec le PS connu et peut etre l'acceptation de voir plus loin que les prochaines echeances.
Peut on en deux ans changer l'image du PS aujourd'hui assimilé aux partis similaires en allemagne ou angleterre?Le PS en a t-il la volonté du moins a sa tete?Rien n'est moins sur.Le referendum sur la constitution sera revelateur non pas par le score du oui et du non mais de l'abstention.Les dirigeants du PS aussi autiste que le gouvernement s'enferment dans les resultats des dernieres elections pour conforter leur analyse,mais que representent quelques militants du PS par rapport au peuple de gauche?
Nous sommes nombreux a partager ton analyse au PS ou ailleurs mais la methode pour y arriver est un sujet de debat pas assez souleve ni commenté.
Juste pour info hormis mon petit cas plus de 25% des militants de mon departement ont preferés partir depuis le dernier congres,a mon avis tres peu étaient de la ligne Hollande...